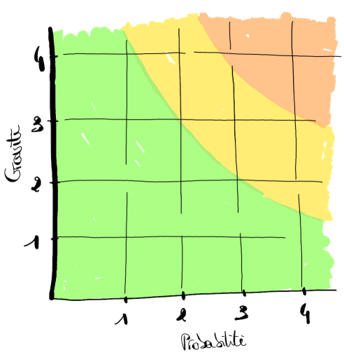L’Agence française anticorruption, dans le guide qu’elle y a dédié en 2021, et actualisé en 2022 porte une attention toute particulière à la prévention des conflits d’intérêts.
Ces derniers, même s’ils ne sont pas explicitement décrits par la loi, ou par les recommandations de l’AFA, présentent un caractère essentiel dans la démarche de prévention de la corruption.
Toutefois l’expérience montre, que si la notion, essentiellement utilisée et observée à l’origine dans la sphère publique, est connue de la plupart des entreprises du secteur privé et de leurs collaborateurs, son contenu et ses contours restent parfois obscurs, et les procédures qui sont censées les encadrer dans l’entreprise, sont souvent mal comprises, faute d’appréhension claire de ce que sont ces fameux conflits d’intérêts.
Une notion mal comprise ou mal perçue
Je ne reviens pas sur la définition de ce que sont ces derniers : le guide de l’AFA est de ce point de vue tout à fait précis, et n’appelle pas de commentaires particuliers. En revanche, la compréhension – opérationnelle, pourrait-on dire – de ce que sont les conflits d’intérêts, au quotidien, dans le sens le plus commun et dans l’acception la plus courante reste, d’expérience, à préciser.
La chose la plus frappante que l’on puisse constater, lorsque l’on aborde la question de ces derniers, c’est qu’ils sont, systématiquement, et probablement à tort, assimilés ou comparés, à une fraude, ou à une malversation quelconque. Alors que paradoxalement, « le délit de conflit d’intérêts n’existe pas dans notre code pénal », comme l’a rappelé Martin Hirsch dans son ouvrage consacré à la question. Mais ces derniers sont le substrat nécessaire à la prise illégale d’intérêts pour la sphère publique décrite aux articles 432-12 et 432-13 du code pénal, et plus simplement le substrat à de nombreuses formes de fraude et de corruption, dans la sphère privée aussi. Le conflit d’intérêts est donc le comburant, pas l’essence d’une qualification pénale, mais le prévenir, c’est s’affranchir de bien des déconvenues.
Malgré cela, il n’est pas possible de parler de conflit d’intérêts à quelqu’un sans que ce dernier pense qu’au mieux la morale, ou au pire la réglementation, ne seront trahies à la seule évocation de ces 3 mots.
Et cet état de fait pose un réel problème quant à la prévention de ces derniers.
Dans la mesure où l’on assimile le conflit d’intérêts à une fraude, ou à une entorse quelconque à la loi ou à la morale, on aura alors la plus grande peine à le déclarer. Soit parce qu’on ne sent pas fraudeur et, de fait, pas en situation de conflit d’intérêts. Soit parce qu’on l’est, fraudeur, et qu’on ne va pas se précipiter pour se déclarer comme tel ! Plaisanterie mise à part, cette perception – confusion est une réalité avec laquelle il faut composer. Et la chose n’est pas aisée.
Cette réalité – de terrain – diraient certains, a pour résultante immédiate que dans l’entreprise, petite ou grande, on peut interroger 10, 100 ou 1000 personnes. De façon certainement caricaturale, toutes diront que le conflit d’intérêts est parfaitement clair dans leur esprit, qu’elles ont conscience des dommages que cela peut entraîner, qu’elles sont parfaitement au fait des procédures ou des guides en place dans l’entreprise, mais qu’en [complétez !] années de carrière, jamais, au grand jamais, elles n’ont été confrontées au phénomène. Et en formulant cette assertion, elles sont, je n’en doute pas, parfaitement de bonne foi.
Une terminologie à aménager?
Face à cette réalité, plutôt que de faire ou d’essayer de (re)définir ce que sont ces conflits d’intérêts, il conviendrait de commencer par dire ce qu’ils ne sont pas.
Et il apparaît utile de préciser qu’avant de parler de conflit d’intérêts, et c’est peut-être le meilleur moyen d’appréhender la chose, il serait utile de faire la distinction entre les notions de lien et de conflit d’intérêts.
Le lien d’intérêt est, avant de devenir – peut-être – un conflit, celui qui apparaît lorsque la sphère privée de toute personne physique, vient rentrer en collision en quelque sorte, avec la sphère professionnelle.
Autrement dit, la vie privée, pour simplifier, caractérisée par la famille, les amis, les relations, quelles qu’elles fussent, de loisir, politiques, religieuses, vient entrer, non pas (encore) en conflit, mais en relation avec la sphère professionnelle.
A titre d’exemple, un membre d’un club de philatélie[1], rencontre et se lie à un représentant d’un fournisseur de l’entreprise qui l’emploie. Dans ce cas précis, et dans un premier temps, il n’y a pas de conflit d’intérêts. Mais un lien d’intérêt apparaît néanmoins.
Il y a un simple lien d’intérêt, qui fait que la sphère privée, le club de philatélie, vient entrer en « collision » avec la sphère professionnelle, savoir l’entreprise employeuse, et l’un de ses fournisseurs, incarné par l’adhérent et ami de ce club de philatélie.
Dès lors, est-ce que cette relation d’intérêt peut être, à ce stade, qualifiée de conflit d’intérêts ?
Rien n’est certain à ce stade, sinon que le principal intéressé, dans l’exemple qui précède, est le plus mal placé pour en juger. Pourtant la pratique montre qu’une personne reconnaissant un lien d’intérêts ne s’imagine quasiment jamais en situation de conflit d’intérêts.
Et ce cas de figure caractérise une situation où l’on est juge et partie, ce qui ne devrait pas se faire !
Dans un cas semblable, le plus simple est de déclarer à l’entreprise l’existence et la nature de la relation avec représentant d’une tierce partie à l’entreprise, et, quelqu’un d’extérieur à cette relation pourra dire s’il y a conflit d’intérêt ou non, en fonction d’éléments de contexte propres à la situation.
Autre exemple le DRH d’un groupe voit un de ses enfants vouloir postuler dans son groupe. L’idée de népotisme vient à lui traverser l’esprit, et il se pose la légitime question de ce qu’il doit faire. Il déclare bien évidemment que son enfant postule, et un dirigeant, ou un supérieur hiérarchique lui dira probablement que compte tenu de la situation, ce DRH ne doit bien évidemment pas être partie au processus de recrutement, et
- soit l’entreprise ne souhaite pas poursuivre avec le descendant, quelles que soient ses qualités, pour éviter tout risque d’assimilation à un conflit d’intérêts,
- soit l’impétrant suivra un processus de recrutement tout à fait normal dans lequel le DRH n’interviendra à aucun moment utilisant pour cela la faculté de déport. Le processus suivra son cours normal, sans impliquer celui qui revendique un lien d’intérêts avec le candidat.
Deux situations différentes, 2 liens d’intérêt, et dans les 2 cas de figure, la capacité de changer la notion de lien en conflit appartient à un tiers, seul à même de trancher.
Et en pratique ?
Une fois les choses ainsi posées, le lien d’intérêt comme préalable au conflit d’intérêts, et celui‑ci, lui‑même prélude à une potentielle qualification pénale, que faire?
Certaines entreprises ont songé pendant un temps à ce que chaque salarié déclare tous les liens d’intérêt qu’il était en capacité d’identifier, c’est-à-dire toutes les relations appartenant et à la sphère privée et à la sphère professionnelle.
En poursuivant ainsi un but d’exhaustivité, sans autre précision, cette solution n’est probablement pas la plus pertinente, parce qu’elle n’est raisonnablement pas atteignable pour au moins 2 raisons : et d’une la mémoire peut toujours jouer des tours, et de deux ne pas respecter cette règle mettrait immanquablement les salariés à la faute, ce qui les pousserait soit à ne rien déclarer du tout, soit à déclarer tout et n’importe qui, pour être sûr de ne pas se tromper.
Une voie médiane pourrait consister à demander aux salariés à ce qu’ils ne déclarent, les liens d’intérêt les plus manifestes, et les plus directs. Notions subjectives, convenons‑en, mais qui éviteront la surenchère déclarative, d’une part, et pourront facilement être mises en évidence par l’entreprise en cas de dissimulation d’autre part, en cas de difficulté.
Ainsi un cousin au 5ème degré, qui ne serait croisé que lors de noces et banquets, et qui aurait des intérêts chez un fournisseur, ou un client, peu importe, du Groupe du salarié pourrait légitimement être considéré comme un lien d’intérêt, mais suffisamment distant pour qu’il ne constitue pas un risque en la matière.
En revanche, si une fille, un oncle, une sœur, un frère, un voisin de palier, un meilleur ami appartiennent à un groupe qui est en relation avec un salarié, ce lien d’intérêt doit être déclaré, même si même s’il ne constitue a priori aucunement un conflit d’intérêts.
L’honnêteté commande de déclarer ce lien pour que, le moment venu, un tiers à la relation puisse établir si ce lien constitue, ou non d’un conflit d’intérêts.
Par suite, à chaque changement de la situation décrite initialement, il sera du devoir du salarié de préciser que de nouveaux liens d’intérêts sont apparus.
De façon incidente, il convient de se poser la question beaucoup plus délicate de relations amicale, ou devenue telle, entre 2 salariés d’une même entreprise, qui pourrait poser la question de conflits d’intérêts, mais qui pour autant ne serait pas immédiatement visible, et probablement peu propice à la commission d’un acte de corruption, en première intention.
Ce cas de figure, très banal, très courant, peut poser problème. Parce qu’il est justement banal, et très fréquent d’une part. Parce qu’il ressort de l’intime d’autre part.
Il apparaît donc très délicat de déclarer, ou de caractériser, cette forme particulière de lien d’intérêts, qui pour autant peut rapidement mener à des conflits d’intérêts, dont une forme d’expression pourrait être le favoritisme, ou plus rarement l’excès de zèle ou de justice, qui consisterait à pénaliser professionnellement, par peur d’être taxé de complaisance.
Raisonnablement, ce type de lien d’intérêts pourrait être exclu du champ de la prévention de la corruption, son lien avec cette dernière étant a priori plutôt ténu. Et c’est plutôt sur le terrain de la fraude qu’il pourrait avoir une résonnance particulière.
Encore un registre ?
En pratique pour suivre les liens d’intérêts, il serait bien évidemment utile de mettre en place un registre y relatif, qui pourrait prendre la forme d’un fichier en ligne, facilement accessible à la saisie, et bien évidemment consultable par un nombre très limité de personnes. Registre finalement assez semblable à ceux souhaités par l’AFA pour les cadeaux et invitations. Registre bien évidemment inscrit à celui (je sais, un autre !) des traitements RGPD.
Pour conclure
Le procédé ici décrit n’est pas parfait, il n’est pas normatif, il est une voie médiane certes contraignante, mais moins que celle qui consisterait à déclarer le moindre lien, sans discernement. Il fait appel au bon sens, à la responsabilité de chacun, et devrait permettre de couvrir une bonne partie des conflits d’intérêts potentiels.
On pourrait objecter qu’il existera des cas de figure où la solution décrite il permet à la fraude ou à la corruption de s’immiscer. Et on répondra que c’est exact. Mais qu’entre rien, et tel procédé, on saura choisir. Et que le pointillisme des exceptions est toujours invocable, mais souvent en vain.
On pourra également objecter, a contrario, que c’est un procédé bureaucratique de plus, ingérable. L’on répondra également que ça n’est pas inexact, mais qu’à partir du moment où tel procédé peut éviter soupçons de quelque nature que ce soit, judiciarisation potentielle – et en croissance ces dernières années, le jeu en vaut peut-être la chandelle, à plus forte raison si l’effort à consentir par chacun est relativement limité. Et que si les situations déclarées avaient à évoluer au cours de l’existence, la formalisation de leur évolution ne devrait pas être insurmontable non plus.
La démarche proposée pourra paraître à certains intrusive. Elle est parfois difficile à mettre en œuvre mais elle est la seule qui puisse être utilement employée dans la mesure où la notion de conflit d’intérêts est excessivement difficile à être acceptée par les collaborateurs d’une entreprise, quels qu’ils soient, du plus modeste au plus haut échelon hiérarchique.
La notion de lien d’intérêt est peut‑être plus facile à appréhender, et ne laisse en aucun cas les salariés juger eux-mêmes de la caractérisation de la relation, qui les unit à telle ou telle personne externe à l’entreprise.
Tel est peut‑être le petit caillou philosophal qui permettra d’appréhender plus facilement cette subtile notion !
[1] Peut être pas un club philatélie, mais attention aux partenaires de golf oui CCass. Crim. 5 avril 2018